Les territoires accueillants,Outils, contacts pour s'installer,S'installer à la campagne,Vivre à la campagne
De l’exode urbain à la renaissance rurale

Depuis la crise sanitaire du Covid, les allégations vont bon train au sujet des migrations des urbains vers la campagne. Dans son dernier ouvrage, le journaliste Frédéric Ville interroge ce phénomène dit d’exode urbain, souligne la continuité de ce mouvement et regrette le regard trop urbain que le Gouvernement porte sur cette réalité.
Propos recueillis par Lucile Vilboux
Pourquoi ce livre ? Et surtout ce titre ? En quoi nous a-t-on menti ?
Je me suis interrogé pendant la crise sanitaire du Covid. La presse parlait d’exode urbain et de revanche rurale. Ces termes me paraissaient exagérés. Plusieurs études ont mesuré ce phénomène et notamment celle du Gouvernement, confiée en 2021 à la Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines. Cette dernière a conclu qu’il y avait bien eu un mouvement des villes vers la campagne mais que ce dernier avait été beaucoup plus diffus que ce qui avait été clamé dans les médias. L’étude soulignait qu’il s’agissait plutôt d’une accentuation de migrations qui existaient déjà depuis les années 70, principalement entre les villes et leurs couronnes, ainsi que vers certains territoires ruraux au sud-ouest d’une ligne Saint-Malo/Genève ou encore, le long des littoraux notamment atlantiques. Les chercheurs de cette étude l’ont donc qualifié de renaissance rurale, si bien que les médias sont passés d’un discours sur l’exode urbain à : « circuler, il n’y a rien plus à voir ». J’ai voulu vérifier ce qui s’était réellement passé jusqu’à aujourd’hui.
« La perception rêvée de la campagne a été très forte pendant la crise sanitaire et se poursuit aujourd’hui. »
Qu’avez-vous découvert ? Les migrations vers la campagne se poursuivent-elles ? Et pour quelles raisons ?
Je savais que dans certains villages, il n’y avait plus de maisons à vendre, mais c’est tout. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Et finalement, en croisant des enquêtes et des données, j’ai constaté que les migrations vers la campagne se sont bien poursuivies jusqu’à aujourd’hui, même s’il y a eu un léger fléchissement depuis la fin de la crise sanitaire. Les statistiques relatives aux contrats de réexpédition de La Poste sont à ce titre intéressantes. En 2018 et 2019, dans les secteurs situés hors des Aires d’attraction des villes (AAV), il y avait par exemple 1,25 entrée pour une sortie. Le taux a grimpé à 1,42 en 2021, au cœur de la crise sanitaire, pour ne retomber qu’à 1,36 en 2022. Les bourgs ruraux, les petites villes ont été particulièrement attractifs et le sont toujours. Par contre, les territoires du quart nord-est de la France restent encore mal-aimés.
Je citerais trois phénomènes principaux qui incitent les urbains à quitter la ville. Le premier est la perception rêvée de la campagne qui a été très forte pendant la crise sanitaire et qui se poursuit. Il faut dire que les confinements ont été, de manière générale, plus faciles à vivre dans les villages qu’en ville. Dans ce contexte, l’essor du télétravail a également été une révélation pour de nombreux salariés. Il leur permettait de déménager tout en conservant leur emploi. D’après l’Insee, en 2017, 3 % d’entre eux le pratiquaient au moins un jour par semaine. Ce chiffre a atteint 19,4 % en 2022. En 2024, selon une enquête de l’Ifop sur les entreprises et les tiers-lieux, il serait désormais de 32 %. Malgré le rétropédalage de certains employeurs, il sera difficile de revenir en arrière. Des accords d’entreprises ont été signés, les surfaces de bureaux parfois réduites et le télétravail fait désormais souvent partie des négociations lors d’embauches.
Enfin, entre temps, l’inflation et la crise économique ont rendu les villes très chères, trop pour nombre d’urbains qui les ont finalement quittées.
« Ils ont quitté la ville par refus d’une vie trop tournée vers la consommation, ou pour gagner en qualité de vie, ou encore pour des raisons économiques. »
Dans un long chapitre, vous dressez les portraits de personnes récemment installées à la campagne. Pour quelles raisons ?
Chaque changement de vie est une histoire, un parcours, des choix… Ces portraits sont à ce titre instructifs et inspirants. Certains étaient cadres, d’autres ouvriers. Ils ont quitté la ville par refus d’une vie trop tournée vers la consommation, ou pour gagner en qualité de vie, ou encore pour des raisons économiques, suite à un événement familial, ou pour toutes ces raisons à la fois. À l’image de cette habitante de Montpellier qui, suite à un divorce, a décidé de vivre dans une tiny house à 30 mn de route, en pleine campagne, faute de trouver un logement abordable en ville. D’autres franchissent le pas au moment de la retraite, à l’occasion d’une reconversion, de l’arrivée des enfants. Raconter leur insertion locale, leurs bonnes et mauvaises surprises – comme la dépendance à la voiture par exemple –, comment et par qui ils ont été accompagnés et accueillis, m’a permis de montrer que souvent ils apportent une vraie richesse aux territoires. Beaucoup se sont impliqués dans la vie locale, comme Didier Cadenel, éducateur à Marseille, qui est devenu maire de la Chapelle-de-Bragny (Saône-et-Loire). Il reste que ces parcours individuels ne suffisent pas toujours à redynamiser certains territoires ruraux. L’État a aussi son rôle à jouer pour maintenir un minimum de services et d’équipements.
Dans la conclusion de votre ouvrage, vous exprimez un regret quant à l’étude du Gouvernement, qui serait selon vous, trop tournée vers l’urbanité. Pouvez-vous nous en donner les raisons ?
L’étude de la Popsu s’est appuyée sur les Aires d’attraction des villes (AAV). Or ces dernières incluent toutes les communes qui envoient au moins 15 % de leurs actifs travailler dans un pôle urbain proche. Si bien qu’en France, selon l’Insee, avec un tel critère, la quasi totalité de la population (93%) vit dans l’une des 699 aires d’attraction des villes. Certains villages situés à 50 km d’un centre urbain sont ainsi considérés sous son influence ! Cela minimise la réalité des mouvements de population vers la campagne puisque se déroulant dans ces aires. Je regrette d’ailleurs qu’il n’y ait eu que très peu de voix discordante suite à la parution de cette étude en février 2023, de même qu’elle n’a quasiment pas fait appel à des spécialistes de la ruralité. Je pense notamment à Olivier Bouba-Olga, enseignant-chercheur en aménagement du territoire à l’Université de Poitiers, Benoît Coquard, sociologue à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), Gérard-François Dumont, démographe et géographe ou encore Valérie Jousseaume, professeur de géographie à l’Université de Nantes.
Pourquoi n’utilise-t-on pas la grille de densité communale, inspirée d’Eurostat ? Elle quadrille le territoire en portions d’un km2 afin d’en mesurer la densité de population. Avec ce mode de calcul, plus d’un tiers de la population française vit dans des communes rurales ! Les campagnes seraient donc plus attractives que ne l’a laissé penser l’étude de la Popsu. Mais admettre cela, c’est aussi reconnaître qu’il faut réinvestir dans ces territoires. Selon une enquête Ifop/Familles rurales (2018, renouvelée et confirmée en mai 2023), 81 % des Français considèrent la vie à la campagne comme le mode de vie idéal. Il faut donc accompagner ce désir et y mettre les moyens. Il ne s’agit pas d’opposer villes et campagnes, mais bien de revenir à un rééquilibrage des territoires qui profite à tous.
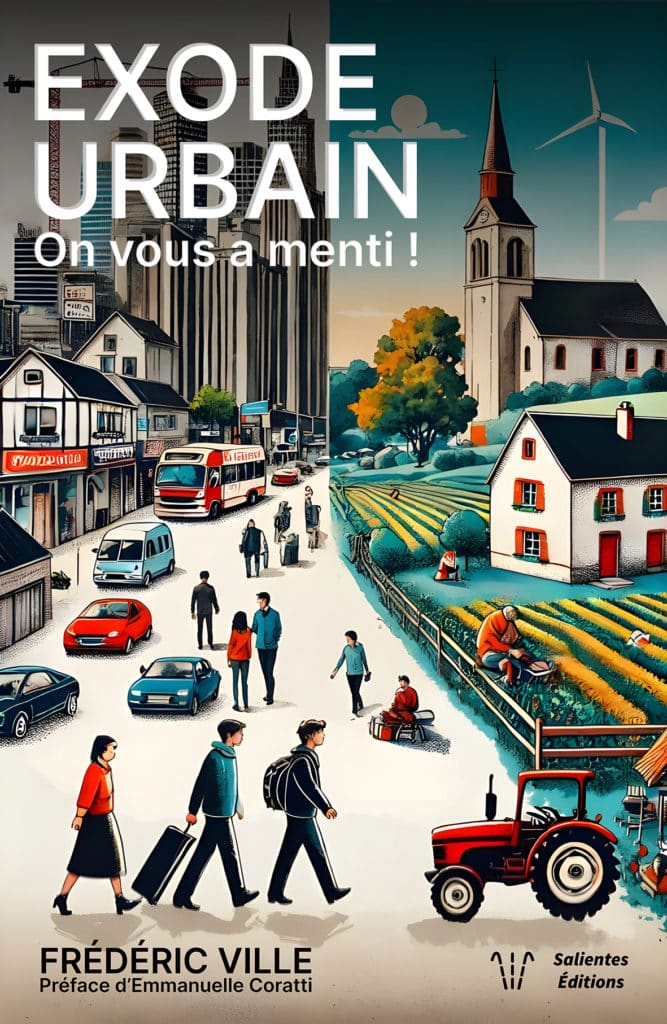 Exode urbain, on vous a menti !
Exode urbain, on vous a menti !
136 p., déc 2024, 18 €.






